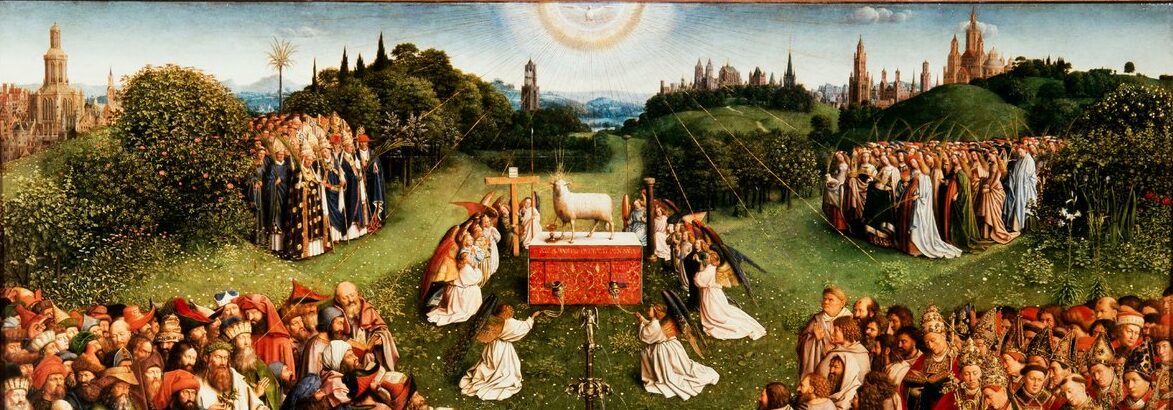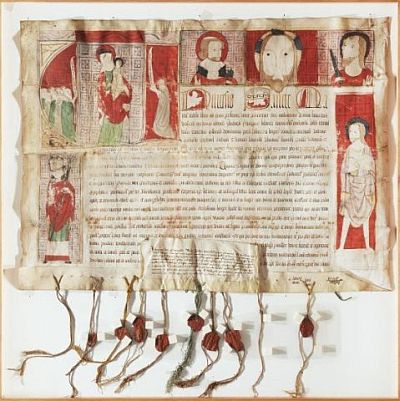
Indulgences pour les defunts
“Que tous fassent grand cas des indulgences”
(l’Église dans le Code de droit canon)
“Pour devenir un saint, il suffit de gagner le plus d’indulgences possibles”
(st Alphonse de Liguori, docteur de l’Église)
L’Eglise nous invite à faire grand cas des indulgences qu’elle attache à certaines prières ou bonnes œuvres et par lesquelles nous est remise la peine due au péché. Il est de foi, en effet, qu’une fois le péché pardonné, il peut rester à satisfaire à la justice divine par quelque peine temporelle, et que, possédant le trésor des mérites infinis de Jésus-Christ et des mérites surabondants de la Sainte Vierge, l’Eglise a le pouvoir de nous les appliquer à nous-mêmes en cette vie ou bien, par manière de suffrage, aux âmes des défunts qui souffrent au Purgatoire.
Rappels des conditions habituelles pour l’Indulgence Plénière appicable pour soi-même ou pour les défunts:
- Accomplir l’œuvre prescrite, avec l’intention (du moins habituelle et générale) de gagner l’indulgence.
- Confession (même dans la semaine précédant ou suivant l’œuvre prescrite) et communion (la veille ou la semaine suivant l’œuvre prescrite).
- Si la visite d’une église est demandée, on peut la faire à partir de la veille depuis midi.
- Faire une prière vocale quelconque selon les intentions du Souverain Pontife, c’est-à-dire de la Sainte Eglise qui sont les suivantes : exaltation de la Foi, extirpation des hérésies, conversion des pécheurs, paix entre les princes chrétiens
- Être en état de grâce
I – Indulgences que l’on peut faire durant toute l’année :
- Requiem æternam etc… : 300 jours chaque fois
- Pie Jesu Domine, dona eis requiem sempiternam 300 jours chaque fois
- Matines et Laudes de l’Office des Morts : 7 ans, Plénière si 30 jours consécutifs. Aux conditions habituelles
- Un nocturne et Laudes de l’Office des Morts : 5 ans
- Vêpres de l’Office des Morts : 5 ans
- De profundis : 3 ans [5 pendant Novembre]
- Pater – Ave – Requiem : 3 ans
- Miserere : 3 ans
- Dies Iræ : 3 ans
- Visite d’un cimetière associée à n’importe quelle prière même mentale pour les défunts: 7 ans
- Récitation de n’importe quelle prière ou exercice de piété pour les défunts avec l’intention de continuer pendant 7 ou 9 jours: 3 ans, 1fois/jour. Plénière aux conditions habituelles si récitée durant les 7 ou 9 jours consécutifs.
II- Indulgences propres à tout le mois de novembre :
N’importe quelle prière ou exercice de piété pour les défunts : 3 ans 1 fois par jour ; plénière si tous les jours du mois (aux conditions habituelles).
III- Indulgences exceptionnelles pour les premiers jours de novembres :
- durant l’Octave de la Commémoration des fidèles défunts (du 2 au 9 Novembre), indulgence plénière pour la visite d’un cimetièr e en récitant une oraison quelconque même mentale pour les défunts : une fois par jour, aux conditions habituelles.
- le 2 novembre ou le dimanche qui suit (donc dans l’Octave, ou l’un ou l’autre) : indulgence plénière pour la visite d’une église ou oratoire public en récitant 6 Pater-Ave-Gloria. On peut gagner l’indulgence plénière autant de fois qu’on le fait (toties quoties). Selon le canon 923, ces indulgences peuvent également être gagnées la veille à partir de midi (à partir de 12h le jour de la Toussaint ou à partir de 12h le samedi suivant).
IV- Ceux qui ont fait l’Acte héroïque de charité en faveur des âmes du Purgatoire peuvent gagner une indulgence plénière aux conditions habituelles:
- toute l’année à chaque communion dans une église ou oratoire public,
- tous les lundis pour l’assistance à une Messe en faveur des âmes du Purgatoire (si c’est impossible, le dimanche qui suit).
Pour les prêtres ayant fait l’acte héroïque de charité : autel privilégié.
Concessions :
Chers fidèles,
Selon le droit canon, le confesseur peut commuter (changer) les conditions pour obtenir les indulgences, qui ne sont pas réalisables.
Par exemple un cimetière est profané par l’enterrement, l’inhumation ou crémation d’un païen, hérétique, schismatique, franc-maçon ou pécheur public. Les églises et chapelles ont été profanées par un culte ou des événements hérétiques et/ou schismatiques.
Ni les prêtres ni les évêques n’en parlent plus. TERRIBLE ! Réveillez-les !!! Ils envoyent leurs fidèles aux cimetières, églises et chapelles profanés (donc invalides) pour gagner des indulgences. Les conditions n’étant plus remplies (visite des cimetières, églises/chapelles CATHOLIQUES), l’indulgence est également invalide. Parce que pour mériter l’indulgence, il faut remplir les conditions. Miserere Domine, miserere nostri !
Code de Droit Canon nr 935 : « Les confesseurs peuvent changer les oeuvres pies imposées pour gagner les indulgences, en faveur de ceux qui sont empêchés légitimement de les accomplir. »
Alors pour tous ceux qui se confessent à votre serviteur (abbé Eric Jacqmin) je change les conditions suivantes :
- la communion le jour même est commutée en une communion spirituelle
- la confession 8 jours avant ou après est commutée par un examen de conscience et une acte de contrition
- la visite à un cimetière catholique (qui n’existe plus pas les désacralisations de nos cimetières) est commutée par une visite à un tombeau manifestement catholique (où il se trouve une croix dessus)
- la visite à une chapelle ou église (qui sont pratiquement tous novus ordo et donc désacralisées) est commutée en la visite d’une chapelle ou église où il n’y a plus ou pas de liturgie du tout (par ex de petites chapelles dédié à des saints). Si ceci est impossible alors une visite suffit à un petit oratoire dans votre maison ou une chambre où vous priez habituellement, une demeure, en tout cas où se trouve un crucifix (mais pas une chambre à coucher!).
- le chemin de croix dans un église est commuté dans le chemin de croix prié à domicile avec un petit crucifix (en bois par préférence)
- le chapelet devant le tabernacle est commuté dans le chapelet devant une statue de la St Vierge reconnue par l’Eglise (donc pas de statues de révélations privées non reconnues) et pensant à un tabernacle où l’Hostie consacrée validement de licitement est gardée respectueusement.
S’il y a d’autres questions, appelez-moi svp.
Bonne dévotion !
Abbé E. Jacqmin+
NB
Extrait du. « TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE », PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE RAOUL NAZ
TOME DEUXIÈME LIVRE, III, CAN. 726-1153
- Répétition des indulgences. — 1. plénières. — CAN. 928, § 1. Une indulgence plénière ne peut être gagnée qu’une seule fois par jour, bien que la même œuvre prescrite soit accomplie plusieurs fois, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement. La possibilité de gagner dans un délai rapproché plusieurs indulgences plénières fut portée devant la S. Congrégation du Concile au début du XVIIe siècle ; peu d’années après son institution, le 7 mars 1678 1, la S. Congrégation des Indulgences déclara qu’on ne peut gagner qu’une fois dans la journée l’indulgence plénière concédée à ceux qui visitent une église à certains jours ou qui font une autre œuvre pie. Elle précisa en 1852 que, dans le premier cas, il s’agissait de jours fixés par la concession, tout en édictant une règle plus sévère pour le cas où ces jours n’étaient pas spécifiés par la concession (cf. can. 921, § 3). Et sa réponse particulière du 29 février 1864 2 permit de conclure qu’on pouvait gagner plusieurs indulgences plénières le même jour en accomplissant des œuvres différentes, conclusion confirmée par l’expression : la même œuvre prescrite du can. 928, § 1. La Portioncule et diverses autres concessions constituent les exceptions prévues par le canon.
Source : TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE RAOUL NAZ
TOME DEUXIÈME LIVRE, III, CAN. 726-1153
NB Voici le texte sur les indulgences dans le même traité
CHAPITRE V
LES INDULGENCES
(CAN. 911-936)
BIBLIOGRAPHIE. F. Beringer, Les indulgences, leur nature, leur usage, 4e éd. franç., 2 vol., Paris, 1925, avec un supplément paru en 1932. – N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, 3 vol., Paderborn, 1922-1923.
I. – CONCESSION.
- Principes. – CAN. 911. Tous feront grand cas des indulgences, c’est-à-dire de la remise devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés quant à la faute, que l’autorité ecclésiastique accorde sur le trésor de l’Église, aux vivants sous forme d’absolution, aux morts sous forme de suffrage.
La rémission des fautes commises après le baptême n’entraîne pas nécessairement la remise des peines temporelles dues pour ces péchés. Peines temporelles infligées par Dieu, notamment au purgatoire après la mort, que l’Église s’efforça de mitiger en imposant elle-même du vivant des fidèles une pénitence, publique ou privée, à accomplir avant ou après l’absolution sacramentelle.
En Occident, le développement de la pénitence privée mène peu à peu au rachat de celle-ci par des aumônes ou de simples prières ; au XIe siècle, apparaissent des remises valables pour tous les fidèles moyennant accomplissement d’une œuvre pie déterminée. C’est ce qu’on appelle les indulgences proprement dites. Celles-ci sont d’abord partielles, c’est-à-dire ne s’étendent qu’à une partie de la pénitence imposée en confession ; ensuite elles deviennent aussi plénières, c’est-à-dire s’étendent à cette pénitence encourue pour tous les péchés accusés en une parfaite et vraie confession, ainsi que s’exprime Urbain II en l’accordant à ceux qui participent à la première croisade vers la Terre sainte. Il est manifeste que dans l’idée du pontife la remise de la peine temporelle vaut également aux yeux de Dieu, et il fut admis que même l’indulgence partielle exprimée pour une durée déterminée de pénitence ecclésiastique comportait également une remise correspondante, impossible à préciser dans le temps, devant Dieu. – Les textes concernant les indulgences se trouvent au livre V des recueils de Décrétales, au titre De poenitentiis et remissionibus.
L’indulgence plénière fut d’abord réservée aux participants à la croisade ; au concile de Latran de 1215, Innocent III l’étendit à ceux qui contribuaient au succès de la croisade et à ceux qui combattaient les hérétiques¹. La première indulgence plénière pouvant être gagnée par la visite d’une église fut celle de la Portioncule² ; une autre fut accordée par Célestin V en 1294, mais révoquée dès l’année suivante par Boniface VIII. Ce dernier pape institua en 1300 l’indulgence plénière dite du jubilé, à gagner tous les cent ans³ ; ce délai fut ramené à cinquante ans par Clément VI en 1343⁴, puis à trente-trois ans par Urbain VI en 1389, enfin à vingt-cinq ans par Paul II en 1470.
Les abus en matière d’indulgences entraînèrent une réprobation trop générale de l’institution elle-même par Wicleff, Huss⁵, Luther⁶ et les protestants. Le concile de Trente proclama le droit de l’Église de conférer des indulgences⁷.
Le can. 911 emprunte quelques termes de sa définition de l’indulgence à la bulle de 1343 sur le jubilé. Il distingue ensuite, dans les termes déjà employés par Benoît XIV⁸, entre l’application aux vivants et celle aux morts : le premier document authentique concernant cette dernière modalité date de 1457 ; l’indulgence ne peut être gagnée à l’intention des défunts que sous forme de suffrage, c’est-à-dire qu’avec l’espoir que Dieu la leur applique⁹.
- Collateurs ordinaires des indulgences. – 1° Leurs pouvoirs. – CAN. 912. En dehors du Souverain pontife, à qui fut commise par le Christ la dispensation de tout le trésor spirituel de l’Église, seuls ceux à qui le droit le concède expressément peuvent accorder des indulgences en vertu de leur pouvoir ordinaire.
Dès le XIe siècle, seuls les papes accordèrent des indulgences plénières, tandis que les évêques se contentaient de concéder des indulgences partielles¹⁰ ; le concile de Latran de 1215 interdit à ces derniers d’octroyer plus d’un an d’indulgence pour une dédicace d’église, plus de quarante jours pour l’anniversaire de celle-ci ou en toute autre circonstance¹¹. La concession d’indulgences à l’occasion de la dédicace d’une église fut étendue à la consécration d’un autel fixe sans dédicace d’église. Mais en dehors de ces cas, les évêques titulaires n’avaient aucun droit d’accorder des indulgences¹². Un décret de la S. Congr. des Indulgences du 28 août 1903¹³ éleva le nombre de jours d’indulgence pouvant être donné en toute circonstance : cinquante jours par les évêques résidentiels sur leur territoire ; cent jours par les patriarches dans tout leur ressort ; deux cents jours par les cardinaux.
Le Code a repris cette disposition (can. 239, § 1, 24° ; 274, 2° ; 349, § 2, 2°), mais depuis, un décret de la S. Pénitencerie du 20 juillet 1942¹⁴ a élevé ces chiffres à cent, deux cents et trois cents jours. Les abbés et prélats nullius (can. 215, § 2 ; 323, § 1), les vicaires et préfets apostoliques (can. 294, § 1), les administrateurs apostoliques permanents (can. 315, § 1) ont les facultés d’indulgence des évêques résidentiels. Ces pouvoirs sont ordinaires, accordés par le droit en vertu de la fonction exercée (can. 197, § 1). Ils sont acquis dès la prise de possession de celle-ci, indépendamment d’un ordre sacré à recevoir.
Le Saint-Siège s’est élevé plusieurs fois contre la concession d’indulgences plénières par les patriarches orientaux, sans indult de sa part¹⁵.
- – 2° Limites de leurs pouvoirs. – CAN. 913. Les inférieurs au Souverain pontife ne peuvent :
1° déléguer à d’autres la faculté de concéder des indulgences, à moins que le Saint-Siège ne le leur ait permis expressément ;
2° accorder des indulgences applicables aux défunts ;
3° ajouter à la même chose, au même acte de piété, à la même confrérie, auxquels des indulgences ont déjà été concédées par le Saint-Siège ou par quelqu’un d’autre, de nouvelles indulgences, à moins que ne soient prescrites de nouvelles conditions à remplir.
Un pouvoir ordinaire peut généralement être délégué, sauf dans les cas expressément prévus par le droit : la délégation, par les collateurs inférieurs au Souverain pontife, du pouvoir de concéder des indulgences constitue une de ces exceptions. Avant le Code, on discutait pour savoir si les indulgences concédées par eux étaient applicables aux défunts ; le can. 913, 2° tranche le débat par la négative. Le can. 913, 3° transforme en règle générale des décisions particulières portées par la S. Congr. des Indulgences¹⁶. - Deux formes d’indulgence plénière. – Les concessions d’indulgences plénières ne peuvent se faire que par le Saint-Siège ou en vertu d’une délégation de sa part. Le Code en étudie deux formes aux can. 914-918 ; les trois premiers canons concernent une délégation proprement dite (on en trouve une autre au can. 468, § 2).
1° La bénédiction papale.
Boniface VIII attacha une indulgence de cent jours à la bénédiction papale, Urbain VIII une indulgence plénière¹⁷. En outre, les papes déléguèrent à d’autres le droit de donner cette bénédiction en leur nom. Benoît XIV, dans une Constitution du 19 mars 1748¹⁸, prescrivit le rite à suivre à cet effet par les réguliers dans leurs églises. Clément XIII, par Constitution du 3 septembre 1762¹⁹, abolit toutes les délégations accordées à titre personnel, mais concéda un nouveau privilège aux chefs de circonscription ecclésiastique : ceux ayant la dignité épiscopale pourront donner la bénédiction papale, à la fin de la messe solennelle, à Pâques et à une autre fête solennelle de leur choix ; ceux n’ayant que l’usage des pontificaux ne pourront le faire qu’à l’un des jours où cet usage leur est permis. Le même pape indique par ailleurs la formule à observer et interdit aux réguliers d’user de leur privilège les jours où les chefs de circonscription ecclésiastique exerceront le leur.
CAN. 914. Les évêques dans leur diocèse peuvent accorder la bénédiction papale avec indulgence plénière, selon la formule prescrite, deux fois par an, c’est-à-dire le jour solennel de Pâques et à une autre fête solennelle à désigner par eux, même s’ils ne font qu’assister à la messe solennelle ; les abbés et prélats nullius, les vicaires et préfets apostoliques, même s’ils n’ont pas la dignité épiscopale, peuvent le faire dans leur territoire un jour solennel par an seulement.
La S. Congr. des Rites rappela à plusieurs reprises que la formule prescrite par Clément XIII devait être observée²⁰ ; mais, alors que normalement les prélats devaient chanter eux-mêmes la messe solennelle, elle permit à certains de la faire célébrer par d’autres, en se contentant d’y assister personnellement²¹. Cette tolérance est générale en vertu du can. 914. La S. Pénitencerie a déclaré, le 25 avril 1922, que le pouvoir accordé par le can. 914 ne pouvait pas être délégué. La Commission d’interprétation du Code a répondu, le 17 février 1930²², que le prélat, se trouvant à la tête de plusieurs territoires et ne pouvant accorder la bénédiction papale que dans l’un d’eux le jour de Pâques, n’avait pas le droit, pour l’autre territoire, de la transférer de sa propre autorité.
Enfin, le décret de la S. Pénitencerie du 20 juillet 1942, augmentant le nombre de jours d’indulgence que peuvent accorder les chefs de territoires ecclésiastiques (can. 912) a en outre permis aux abbés et prélats nullius, aux vicaires et préfets apostoliques, de donner désormais la bénédiction papale deux fois par an, comme le pouvaient jusqu’alors les évêques ; il a concédé à ceux-ci de le faire trois fois par an, c’est-à-dire à deux jours de leur choix. Il ne précise pas davantage qu’auparavant quels doivent être ces jours : certains auteurs exigent une fête d’obligation ; d’autres se contentent d’une occasion, par ex. un pèlerinage, où l’assistance à la messe est au moins égale à celle d’un jour d’obligation.
CAN. 915. Les réguliers, qui ont le privilège d’accorder la bénédiction papale, sont non seulement tenus par l’obligation d’employer la formule prescrite, mais ils ne peuvent user de ce privilège que dans leurs églises, dans celles des moniales ou des tertiaires légitimement agrégés à leur ordre ; cela, pas aux mêmes jour ni lieu que l’évêque.
À la suite de différentes questions posées à la S. Congr. des Indulgences²³, Léon XIII, dans sa Constitution du 7 juillet 1882²⁴, distingue soigneusement la bénédiction papale que les réguliers peuvent donner dans leurs églises deux fois par an, suivant le rite prescrit par Benoît XIV, de l’absolution générale avec indulgence plénière conférée aux membres ou aux tertiaires de leur ordre, la veille des principales fêtes, et pour laquelle il promulgue deux nouvelles formules²⁵. Atténuant la règle de Clément XIII, il ajoute que les réguliers ne peuvent donner la bénédiction papale proprement dite le même jour que l’évêque, si c’est dans le même lieu que lui. Le can. 915 reprend cette discipline : par évêque, il faut entendre tout chef de circonscription ecclésiastique ; par lieu, la ville ou bourgade où il pontifie ce jour-là. En 1754²⁶, la S. Congr. des Indulgences avait précisé que les réguliers ne pouvaient donner la bénédiction papale que dans les églises de leurs couvents ; le can. 915 adopte une tolérance plus large. Et, à propos des tertiaires, le S. Office a décrété, en 1910, que n’importe quel prêtre ayant juridiction pour confesser pouvait leur donner la bénédiction papale à défaut d’un prêtre de l’ordre²⁷, et, en 1914, que les supérieurs réguliers pouvaient déléguer un prêtre de l’ordre n’ayant même pas cette juridiction²⁸.
Un décret de la S. Congr. des Rites, du 12 mars 1940²⁹, a déclaré que les prêtres séculiers, recevant du Saint-Siège la faculté de donner au peuple la bénédiction papale proprement dite à des jours déterminés, devaient employer la même formule que les réguliers, c’est-à-dire celle de Benoît XIV.
Ni le can. 915 ni ce décret ne concernent la bénédiction papale que les prédicateurs ont le droit d’accorder à l’issue d’une mission prêchée par eux.
- – 2° L’autel privilégié. – La faveur de l’autel privilégié consiste en ce que la messe célébrée à cet autel s’accompagne d’une indulgence plénière qui, actuellement, n’est plus concédée qu’exceptionnellement comme applicable aux vivants³⁰. Le privilège fut primitivement local – le premier exemple date de 1537 – c’est-à-dire jouait lorsque la messe était célébrée par n’importe quel prêtre à un autel déterminé ; il fut donné par la suite à titre personnel, et valait alors pour un prêtre déterminé, quel que fût le lieu où il célébrait ; il peut également être mixte. Selon la volonté de l’Église, la messe doit être appliquée à l’intention des défunts³¹, mais, selon un décret du S. Office du 20 février 1913, elle ne doit plus, pour la validité de l’indulgence, être messe de Requiem ou comprendre la mémoire des défunts lorsque les rubriques le permettent³².
- CAN. 916. Les évêques, les abbés et prélats nullius, les vicaires et préfets apostoliques, les supérieurs majeurs d’une religion cléricale exempte, peuvent désigner et déclarer privilégié pour chaque jour et à perpétuité un autel, pourvu qu’il n’y en ait pas d’autre déjà privilégié dans leurs églises cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, quasi-paroissiales, mais non dans les oratoires publics ou semi-publics, à moins qu’ils ne soient unis ou soumis à l’église paroissiale.
Benoît XIII, par une Constitution du 20 août 1724³³, accorda aux évêques de désigner dans leur église cathédrale un autel privilégié de leur choix, si elle n’en possédait pas encore. En vertu d’un décret de la S. Congr. des Indulgences du 19 mai 1759³⁴, les évêques et les abbés nullius purent également obtenir la faculté, renouvelable tous les sept ans, de désigner un autel privilégié dans chaque église paroissiale, abbatiale et collégiale. En diverses réponses, la même Congrégation précisa que cette faculté s’appliquait aux églises non strictement appelées collégiales mais où l’office du chœur était assuré, et aux églises filiales où avaient lieu les fonctions paroissiales³⁵ (mais non pour un second autel aux églises paroissiales en même temps cathédrales)³⁶, et qu’elle concernait tous les chefs de circonscription ecclésiastiques, mais non les vicaires généraux ou délégués³⁷. Enfin la Congrégation déclara que le privilège à titre local n’exige pas que l’autel soit fixe, au sens liturgique strict, mais simplement, alors que seule la pierre est consacrée, que l’autel (même s’il est en bois) soit placé de façon stable³⁸. Le can. 916 inclut dans son énumération les abbés ou supérieurs majeurs réguliers, qui peuvent désigner un autel privilégié dans l’église de chaque abbaye ou couvent relevant de leur juridiction, sauf si cette église est cathédrale ou paroissiale (auquel cas la désignation appartient au chef de la circonscription ecclésiastique).
CAN. 917, § 1. Le jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, toutes les messes jouissent du privilège, comme si elles étaient célébrées sur un autel privilégié.
La S. Congr. des Indulgences avait accordé cette faveur à toute l’Église latine par décret du 19 mai 1761³⁹. Benoît XV la renouvela par sa Constitution du 10 août 1915⁴⁰. Un décret de la S. Pénitencerie du 31 octobre 1934 l’étendit à toutes les messes célébrées pour les défunts pendant l’octave de la Commémoraison⁴¹. Ce privilège se gagne même si la messe est célébrée sur un autel absolument mobile, en dehors d’une église ou d’un oratoire, et est donc personnel ; dans les messes dites pour plusieurs ou pour tous les fidèles défunts, le célébrant doit positivement appliquer l’indulgence plénière à un seul. D’autres cas personnels d’autel privilégié sont indiqués dans le Code (can. 239, § 1, 10° ; 349, § 1, 1° ; 294, § 1 ; 315, § 1 ; 323, § 1).
CAN. 917, § 2. Pendant les jours où est célébrée la supplication des Quarante heures, tous les autels de l’église sont privilégiés.
L’exposition du Saint-Sacrement pendant quarante heures continues prit son origine en Italie au XVIe siècle ; Clément XI en fixa les règles en 1705 ; Pie VII, le 10 mai 1807, concéda la faveur de l’autel privilégié pendant toute sa durée à tous les autels de l’église où elle avait lieu. Dans diverses régions le Saint-Sacrement n’était cependant exposé que de jour et, le 22 janvier 1914, le S. Office étendit les indulgences à cette modalité ; c’est dans ce sens qu’il faut entendre le can. 917, § 2. Cette faveur de l’autel privilégié affecte à titre local tous les autels stables de l’église (cf. can. 1275), mais ne concerne pas les oratoires.
CAN. 918, § 1. Pour indiquer qu’un autel est privilégié, on n’inscrira que les mots : autel privilégié, avec l’indication, selon les termes de la concession, que celle-ci est perpétuelle ou provisoire ; quotidienne ou non.
Le privilège peut être accordé à perpétuité ou pour une période déterminée ; dans les deux hypothèses, il peut valoir pour tous les jours ou pour un certain nombre de jours ; si, dans les limites du nombre indiqué, le choix des jours est libre, l’intention de faire usage du privilège doit évidemment exister.
CAN. 918, § 2. Pour les messes célébrées sur un autel privilégié, un plus grand honoraire ne peut être exigé sous prétexte du privilège.
Cette règle fut établie par la S. Congr. des Indulgences à propos du 2 novembre, le 19 mai 1761⁴². Si elle est transgressée, l’indulgence n’est pas gagnée ; le privilège, s’il est personnel, est à jamais perdu⁴³ ; et, si les conditions nécessaires pour encourir la peine existent, le prêtre est frappé ipso facto de l’excommunication simple réservée au Saint-Siège (can. 2327).
- Publication des indulgences. – 1° Intervention de l’Ordinaire du lieu. – CAN. 919, § 1. Les nouvelles indulgences, même concédées aux églises des réguliers, qui n’ont pas été promulguées à Rome, ne peuvent être publiées sans consentement de l’Ordinaire du lieu.
§ 2. On observera la prescription du can. 1388 dans l’édition des livres, libelles, etc., qui énumèrent les concessions d’indulgences pour les différentes prières ou œuvres pies.
Déjà le concile de Trente ordonna que la publication des indulgences se fît par l’intermédiaire des Ordinaires de lieu⁴⁴, prescription que les papes⁴⁵ et les dicastères romains⁴⁶ rappelèrent à plusieurs reprises. La S. Congr. des Indulgences précisa toutefois que cette intervention n’était pas nécessaire pour les indulgences promulguées urbi et orbi par le pape⁴⁷. En ce qui concerne les autres, on discute pour savoir si le can. 919, § 1 doit se comprendre, dans le sens d’indulgences concédées « aux églises, même des réguliers », et n’affecter donc que les indulgences concédées à une église, un autel, une communauté ; ou s’il doit s’entendre d’une façon toute générale et s’appliquer même aux indulgences concédées à titre purement personnel. Quoi qu’il en soit, le can. 919, § 1 n’affecte pas la validité du gain des indulgences accordées par le Saint-Siège, sauf lorsqu’il s’agit d’une communication d’indulgence par une archiconfrérie agrégée. Le can. 919, § 1, par opposition au can. 919, § 2, ne concerne que la publication orale ou la divulgation privée d’indulgences ; une autorisation verbale de l’Ordinaire peut alors suffire et un texte manuscrit ou équivalent ne devrait pas en porter mention.
La divulgation écrite publique d’indulgences tombe sous les règles de la censure des livres et plus spécialement sous le can. 1388, qui prévoit l’imprimatur de l’Ordinaire du lieu, ou même l’autorisation du Saint-Siège pour certaines publications de caractère général.
L’édition de 1898 d’une œuvre privée, imprimée à Rome⁴⁸ et intitulée Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le sacre indulgenze, fut reconnue comme authentique par le Saint-Siège ; une traduction française en parut à Rome en 1901⁴⁹ et reçut également cette approbation officielle. La S. Pénitencerie, par décret du 22 février 1929⁵⁰, publia un supplément authentique et exclusif à cet ouvrage sous le titre : Collectio precum piorumque operum quibus Romani Pontifices in favorem omnium Christifidelium aut quorumdam coetuum personarum indulgencias adnexerunt ab a. 1899 ad 1928. Par décret du 31 décembre 1937⁵¹, elle promulgua une nouvelle collection authentique : Preces et pia opera in favorem omnium Christifidelium aut quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata et opportune recognita. Enfin, par décret du 30 janvier 1950⁵², elle a reconnu comme seul valable le nouvel Enchiridion indulgentiarum édité par ses soins. Les concessions générales d’indulgences qui ne sont pas indiquées dans le recueil doivent être considérées comme abrogées.
- – 2° Législation par la S. Pénitencerie. – CAN. 920. Ceux qui ont obtenu du Souverain pontife des concessions d’indulgences pour tous les fidèles sont tenus, sous peine de nullité de la grâce obtenue, de porter un exemplaire authentique de ces concessions à la S. Pénitencerie.
Benoît XIV confia à la S. Congr. des Indulgences⁵³ la légalisation de certaines indulgences accordées directement par les Souverains pontifes. En 1904 la S. Congr. des Rites, puis en 1908 le S. Office⁵⁴ reprirent cette fonction. Pie X décréta le 7 avril 1910⁵⁵ que toute concession d’indulgence, générale ou particulière, non strictement personnelle, de même que la concession de bénir des objets pieux et d’y attacher concrètement des indulgences (déjà accordées en principe pour de tels objets), devaient être soumises à la légalisation sous peine de nullité de la grâce obtenue⁵⁶. Mais Benoît XV, le 16 septembre 1915⁵⁷, supprima cette formalité pour la seconde catégorie indiquée par Pie X et pour toutes les concessions particulières. Sa décision est à la base du can. 920. Que dire des indulgences qui concernent « tous les fidèles » mais exigent la visite d’un lieu déterminé ? Certains prétendent que le can. 920 leur est applicable, d’autres disent que celui-ci ne vise que les indulgences à gagner par tous, en tous temps et en tous lieux.
Lorsque le pape signe lui-même un exemplaire d’une concession d’indulgence, c’est cet autographe qui sera porté à la S. Pénitencerie ; en cas de concession orale, c’est une attestation écrite de celle-ci par un cardinal (can. 239, § 1, 17°), ou par un autre dignitaire compétent pour en témoigner, qui sera remise. - Jours prescrits pour les indulgences. – 1° Détermination du jour. – CAN. 921, § 1. Une indulgence plénière concédée pour les fêtes de Notre-Seigneur Jésus-Christ ou pour les fêtes de la bienheureuse Vierge Marie ne s’entend que pour les fêtes qui figurent au calendrier de l’Église universelle.
§ 2. Une indulgence plénière ou partielle concédée pour les fêtes des apôtres est entendue comme accordée seulement pour le jour anniversaire de leur martyre.
§ 3. Une indulgence plénière, concédée comme quotidienne, perpétuelle ou pour un temps déterminé et ceux qui visitent une église ou un oratoire public, peut être gagnée par tout fidèle n’importe quel jour, mais seulement une fois l’an, à moins que le décret de concession ne dise le contraire.
La S. Congr. des Indulgences établit ces deux premières règles en 1862⁵⁸, la troisième en 1852⁵⁹. Par opposition à la deuxième, la première ne concerne que les indulgences plénières. La troisième également d’ailleurs, et uniquement celles s’obtenant par la visite d’une église ou d’un oratoire public, à un jour qui n’est pas fixé dans la concession mais laissé éventuellement dans certaines limites au choix des fidèles. Des exceptions sont en outre prévues.
- – 2° Transfert du jour. – CAN. 922. Les indulgences annexées à des fêtes, supplications ou prières ayant lieu pendant neuf, sept ou trois jours, avant ou après le jour principal ou au cours de son octave, sont censées transférées en même temps que ce jour l’est légitimement, si l’office et la messe de la fête sont transférés à perpétuité sans qu’il y ait solennité ou célébration extérieure, ou si la solennité et la célébration extérieure sont transférées pour un temps ou à perpétuité.
Le gain des indulgences est plus une pratique populaire que liturgique : il suit donc avant tout la solennité extérieure, c’est-à-dire le jour où le peuple se rend à l’église pour la célébration en question. Déjà à cet effet la S. Congr. des Indulgences avait accordé, dans des cas d’espèces, plusieurs transferts d’indulgences⁶⁰, et c’est ce qui l’amena⁶¹ à décider de façon générale, le 9 août 1852⁶², qu’en cas de transfert de solennité, même pour une seule fois et sans translation de l’office ni de la messe, l’indulgence est transférée également, mais que, si le jour de la solennité ne change pas, l’indulgence y demeure attachée, même si la messe et l’office sont transférés à perpétuité. La S. Congr. répondit en 1878⁶³ – le S. Office confirma en 1912⁶⁴ – que ce transfert perpétuel n’entraîne celui de l’indulgence que s’il n’y a pas de solennité extérieure. Le can. 922 reprend ces dispositions ; il dit implicitement qu’un transfert non perpétuel d’office et de messe n’entraîne pas celui de l’indulgence, même s’il n’y a pas de solennité extérieure, ce que répondit d’ailleurs explicitement la S. Pénitencerie le 18 février 1921⁶⁵. Celle-ci précisa aussi, le 14 décembre 1937⁶⁶, que le transfert de solennité doit comporter une célébration religieuse et non point simplement civile.
Le S. Office avait décrété, le 14 décembre 1916⁶⁷, que l’indulgence toties quoties du 2 novembre suivait le transfert liturgique de la Commémoraison de tous les fidèles défunts ; cette disposition demeure en vigueur, quoiqu’elle ne cadre pas complètement avec le can. 922, spécialement là où l’affluence au cimetière et à l’église voisine a lieu dès le matin (cf. can. 923) du 2 novembre, lorsque ce jour est un dimanche. Un décret de la S. Pénitencerie du 2 janvier 1939⁶⁸ permet de gagner l’indulgence toties quoties du 2 novembre le dimanche suivant.
La S. Congr. des Indulgences avait décrété, le 12 janvier 1878⁶⁹, qu’une même personne ne peut, par suite d’une translation, gagner les indulgences attachées à une fête identique, une première fois en un endroit et une seconde fois en un autre. La S. Pénitencerie répondit le 13 janvier 1930⁷⁰ que cette règle ne s’applique pas à la Portioncule⁷¹. - – 3° Anticipation. – CAN. 923. Pour gagner une indulgence attachée à un jour déterminé, si la visite d’une église ou d’un oratoire est requise, celle-ci peut se faire depuis midi du jour précédent jusqu’à minuit du jour propre.
La S. Congr. des Indulgences avait toujours fait courir le délai, pour gagner une indulgence, de minuit à minuit ; le S. Office modifia cette disposition le 26 janvier 1911⁷² dans le sens indiqué au can. 923. - Cessation des indulgences. – 1° Locales. – CAN. 924, § 1. En conformité avec le can. 75, les indulgences attachées à une église ne cessent pas si l’église est complètement détruite mais reconstruite dans les cinquante années qui suivent, au même ou à peu près au même endroit et sous le même patronage.
Le can. 75 statue que les privilèges locaux revivent si le lieu est rétabli dans les cinquante ans qui suivent sa disparition. Dans l’ancien droit, ce principe était surtout affirmé justement par la S. Congr. des Indulgences qui précisait qu’une église devait être réédifiée au même endroit et non par ex. sur l’emplacement du cimetière voisin⁷³ ; elle admettait toutefois un écart de vingt à trente pas⁷⁴. Il suffit qu’une partie de l’église nouvelle coïncide, même à vingt ou trente pas, avec l’emplacement de l’ancienne ; et que la reconstruction ait simplement commencé dans les cinquante années qui suivent la destruction. - – 2° Réelles. – CAN. 924, § 2. Les indulgences attachées aux chapelets et autres objets sont perdues seulement lorsque ceux-ci cessent complètement d’exister ou sont vendus.
Le mot seulement indique, ainsi que l’a confirmé la S. Pénitencerie le 18 février 1921⁷⁵, la différence avec l’ancien droit : en effet, selon un décret de la S. Congr. des Indulgences du 6 février 1657⁷⁶, plusieurs fois rappelé par elle, non seulement la vente mais aussi le prêt ou le don d’objets entraînaient la perte des indulgences y attachées. La S. Congr. précisa toutefois que les indulgences ne se perdent pas si, après avoir commandé un objet, on le fait bénir par le vendeur, même si on ne le paie que plus tard⁷⁷.
L’indulgence attachée aux crucifix l’est à l’image du Christ, en sorte qu’elle ne se perd pas si le bois de la croix est brisé ou renouvelé. Celle du chemin de croix est attachée aux quatorze croix de bois qui surmontent les images ; il ressort de différentes réponses particulières de la S. Congr. des Indulgences que ni la destruction totale de ces images⁷⁸, ni la réparation partielle de toutes les croix⁷⁹, ni même le remplacement de quelques-unes⁸⁰, ni le transfert du chemin de croix en un meilleur endroit de la même église⁸¹, n’entraînent la perte de l’indulgence. La S. Pénitencerie a déclaré, le 21 décembre 1925⁸², que les indulgences ne peuvent être attachées à des chapelets en étain, en plomb, en verre, ou en une autre matière semblable. Un chapelet ne doit être dit détruit que s’il se brise et que si en même temps la moitié des grains se perd ; le renouvellement successif des grains n’entraîne pas perte de l’indulgence.
II. – ACQUISITION DES INDULGENCES
Le Code formule d’abord certains principes généraux (can. 925-926) ; il entremêle ensuite des règles pratiques concernant toutes les indulgences (can. 927-928, 930, 932-933, 935-936), ou certaines œuvres prescrites particulières (can. 929, 931, 934).
- Principes. – 1° Capacité de gagner les indulgences. – CAN. 925, § 1. Pour être capable de gagner des indulgences pour soi-même, il faut être baptisé, non excommunié, en état de grâce au moins à la fin des œuvres prescrites, sujet de celui qui concède l’indulgence.
C’est par le baptême que l’homme devient sujet de droits et de devoirs dans l’Église (can. 87) ; un de ces droits est précisément de gagner des indulgences. Mais l’exclusion de la communion des fidèles peut mettre obstacle à l’exercice de ces droits, elle le fait notamment en matière d’indulgences (can. 2262, § 1). La question de savoir si les hérétiques et les schismatiques de bonne foi peuvent gagner des indulgences est discutée.
L’état de grâce est absolument nécessaire afin de gagner une indulgence pour soi-même. Si une série d’œuvres pies est prescrite, il suffit mais il faut que l’état de grâce existe au moment où la dernière œuvre est accomplie, c’est-à-dire où l’indulgence se gagne en fait. Tel fut notamment l’enseignement de S. Antonin et de S. Charles Borromée, repris par Benoît XIV⁸³. Bien entendu si une œuvre à accomplir, par ex. la communion, nécessite de soi l’état de grâce, celui-ci est requis à ce moment-là pour la validité de l’indulgence, même si l’œuvre n’est pas accomplie en dernier lieu. La S. Congr. des Indulgences a précisé, le 17 décembre 1870⁸⁴, que l’état de grâce requis comme tel pour gagner les indulgences peut s’acquérir par la contrition parfaite, et que ceux qui sont déjà en état de grâce ne doivent pas formuler d’acte de contrition spécial.
La S. Pénitencerie a déclaré, le 7 juillet 1917, que les fidèles de rite oriental peuvent gagner toutes les indulgences accordées par un décret universel du pape⁸⁵. Le droit de l’Église établit non seulement quelles autorités inférieures au pape sont les collateurs ordinaires des indulgences (can. 912), mais aussi en faveur de quels sujets ces autorités peuvent exercer leur pouvoir.
Le can. 925, § 1 ne concerne que les indulgences à gagner pour soi-même. Le Code n’a pas voulu condamner de façon explicite l’opinion selon laquelle les catéchumènes pourraient gagner des indulgences en faveur de défunts baptisés ; par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante antérieure⁸⁶, il refuse de trancher la question de savoir si les fidèles doivent être en état de grâce pour appliquer les indulgences aux âmes du purgatoire : dans les cas où cet état n’est pas requis directement ou indirectement (par ex. si la confession et la communion sont exigées), il semble qu’on puisse répondre négativement. - – 2° Efficacité des indulgences. – CAN. 925, § 2. Pour qu’un sujet capable gagne de fait les indulgences, il doit avoir l’intention au moins générale de les acquérir, et accomplir les œuvres prescrites, dans le temps et de la façon voulus par la teneur de la concession.
Beaucoup d’auteurs admettent que l’intention générale de gagner les indulgences peut être habituelle, c’est-à-dire avoir été faite une fois pour toutes, et certains ajoutent même : implicitement. Une telle volonté implicite suffit en tout cas pour le privilège local de l’autel privilégié⁸⁷, et chez ceux qui sont privés de l’usage de leurs sens lors de la bénédiction à l’article de la mort. - CAN. 926. Une indulgence plénière est concédée de telle façon que si quelqu’un ne peut la gagner en entier, il puisse au moins le faire dans la mesure de ses dispositions.
Une indulgence ne s’applique qu’aux péchés déjà remis quant à la faute. Si un fidèle veut donc gagner pour soi une indulgence plénière, tous ses péchés doivent avoir été remis quant à la faute, soit par l’absolution sacramentelle, soit par une contrition parfaite, et, depuis ce moment, il ne peut avoir commis le moindre péché véniel, sinon l’indulgence n’est pas plénière, puisqu’elle ne vaut pas pour ce dernier péché⁸⁸. On voit donc que si, l’état de grâce existant, l’acte de contrition n’est pas nécessaire comme tel pour gagner une indulgence, il pourra, lorsque la contrition est parfaite, donner à l’âme la dernière disposition requise pour s’appliquer une indulgence plénière.
En ce qui concerne les défunts, si Dieu n’accorde pas l’indulgence plénière qui lui est demandée, il accordera une rémission partielle des peines du purgatoire. - Sujétion aux collateurs des indulgences. – CAN. 927. À moins qu’il n’en apparaisse autrement de par la teneur de la concession, les indulgences concédées par un évêque peuvent être gagnées par ses sujets même hors de son territoire et, dans son territoire, même par les pérégrins, les vagi et les exempts.
Ce canon reprend les règles fixées par la S. Congr. des Indulgences dans une réponse particulière du 26 mai 1898⁸⁹. Ce qui est dit des évêques vaut aussi pour les abbés et les prélats nullius (can. 215, § 2 ; cf. can. 323, § 1), les vicaires et préfets apostoliques (cf. can. 294), les administrateurs apostoliques permanents (cf. can. 315, § 1). Le can. 927 applique d’ailleurs le can. 201, § 3 en ce qui concerne les habitants des diverses circonscriptions ecclésiastiques, et le can. 94, § 2 en ce qui concerne les vagi. L’extension de la concession d’indulgences aux pérégrins et aux exempts est analogue au pouvoir qu’a l’Ordinaire du lieu d’absoudre leurs péchés.
De même que les cardinaux peuvent partout absoudre ceux qui se confessent à eux, ils peuvent accorder partout des indulgences aux fidèles présents ; pour le reste, indépendamment de leur pouvoir éventuel de chef de circonscription ecclésiastique, les indulgences qu’ils attachent à des œuvres à accomplir dans les lieux dépendant de leur juridiction ou dont ils sont protecteurs ne peuvent être gagnées que par les personnes relevant de cette juridiction ou d’un institut sous cette protection (can. 239, § 1, 24°). - Répétition des indulgences. – 1° Plénières. – CAN. 928, § 1. Une indulgence plénière ne peut être gagnée qu’une seule fois par jour, bien que la même œuvre prescrite soit accomplie plusieurs fois, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement.
La possibilité de gagner dans un délai rapproché plusieurs indulgences plénières fut portée devant la S. Congr. du Concile au début du XVIIIe siècle ; peu d’années après son institution, le 7 mars 1678⁹⁰, la S. Congr. des Indulgences déclara qu’on ne peut gagner qu’une fois dans la journée l’indulgence plénière concédée à ceux qui visitent une église à certains jours ou qui font une autre œuvre pie. Elle précisa en 1852 que, dans le premier cas, il s’agissait de jours fixés par la concession, tout en édictant une règle plus sévère pour le cas où ces jours n’étaient pas spécifiés par la concession (cf. can. 921, § 3). Et sa réponse particulière du 29 février 1864⁹¹ permit de conclure qu’on pouvait gagner plusieurs indulgences plénières le même jour en accomplissant des œuvres différentes, conclusion confirmée par l’expression : la même œuvre prescrite du can. 928, § 1. La Portioncule et diverses autres concessions constituent les exceptions prévues par le canon. - – 2° Partielles. – CAN. 928, § 2. Une indulgence partielle peut être gagnée plusieurs fois par jour, par la répétition de la même œuvre, à moins que le contraire ne soit indiqué.
Cette règle, qui était d’ailleurs déjà généralement admise par les auteurs, fut confirmée par le S. Office le 25 juin 1914⁹². - Visites d’église. – CAN. 929. Les fidèles des deux sexes qui, pour raison de perfection, d’appartenance à une institution, d’éducation, ou même de santé, vivent en commun dans des maisons constituées du consentement de l’Ordinaire du lieu mais privées d’église ou d’oratoire public, de même que les personnes qui y demeurent pour les servir, chaque fois que pour gagner les indulgences la visite d’une église ou d’un oratoire public indéterminés est prescrite, peuvent visiter la chapelle de leur propre maison dans laquelle ils satisfont à l’obligation d’entendre la messe, pourvu qu’ils accomplissent de la façon voulue les autres œuvres prescrites.
Ce canon reproduit littéralement le décret du S. Office du 14 janvier 1909⁹³. Normalement les visites d’église prescrites pour gagner les indulgences doivent se faire à une église ou un oratoire public, et jusqu’en 1909 seuls des indults particuliers avaient permis d’agir autrement. Pour que joue la règle établie depuis, il faut que la maison ait été érigée, ou reconnue par la suite, par l’Ordinaire du lieu et possède une chapelle où la messe peut être entendue le dimanche ; quelques auteurs se contentent cependant de l’existence d’une telle chapelle, même si la maison dépend exclusivement de l’autorité civile ; ils conviennent toutefois que la règle ne s’applique pas aux prisons. Peu importe pour le reste que ceux qui vivent en commun aient la possibilité ou non de sortir et d’aller gagner les indulgences dans une église ou un oratoire public.
Les cardinaux (can. 239, § 1, 11°), les évêques (can. 349, § 1, 1°), les abbés et prélats nullius (can. 215, § 2), les vicaires et préfets apostoliques (can. 294), les administrateurs apostoliques permanents (can. 315, § 1), ainsi que les familiers se trouvant avec eux, peuvent, pour gagner les indulgences, visiter la chapelle particulière qu’ils emploient, fût-ce dans le lieu d’une simple résidence de fait, même lorsque la visite doit se faire à une église ou à un oratoire déterminés de ce lieu. - Application des indulgences aux défunts. – CAN. 930. Personne ne peut appliquer les indulgences qu’il acquiert à d’autres vivants ; mais toutes les indulgences concédées par le Souverain pontife sont applicables aux âmes du purgatoire, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement.
Un décret de la S. Congr. des Indulgences du 30 septembre 1852 avait déclaré applicables aux défunts toutes les indulgences publiées dans le recueil Raccolta di orazioni e pie opere⁹⁴… ; le can. 930 statue de façon analogue au sujet de toutes les indulgences passées et futures accordées par les papes⁹⁵. - Confession et communion. – 1° Leur date. – CAN. 931, § 1. La confession éventuellement requise pour gagner n’importe quelles indulgences peut avoir lieu dans les huit jours qui précèdent immédiatement le jour auquel est attachée l’indulgence, la communion la veille du même jour, l’une et l’autre pendant toute l’octave suivante.
§ 2. De même, pour gagner les indulgences concédées à ceux qui font de pieux exercices pendant trois jours, une semaine, etc., la confession et la communion peuvent avoir lieu également dans l’octave qui suit immédiatement la fin de l’exercice.
Il s’agit ici uniquement de la confession prescrite comme telle, notamment par les mots contritis et confessis. La S. Congr. des Indulgences déclara, le 19 mai 1759, qu’elle est requise même si l’on ne se souvient pas d’avoir commis des fautes mortelles depuis la dernière absolution reçue⁹⁶, mais précisa, le 15 décembre 1841, qu’il n’était pas nécessaire que l’absolution suive la nouvelle confession⁹⁷. Cette Congrégation permit, le 19 mai 1759, que la confession ait lieu la veille du jour auquel l’indulgence est attachée ; le 11 mars 1908⁹⁸, elle porta le délai à deux ou trois jours selon que l’indulgence pouvait se gagner une ou plusieurs fois dans la même journée ; le 23 avril 1914, le S. Office fixa uniformément⁹⁹ le délai à huit jours préalables. En ce qui concerne la communion, la S. Congr. des Indulgences permit, le 12 juin 1822¹⁰⁰ et le 6 octobre 1870¹⁰¹, qu’elle ait lieu la veille.
La nouveauté du can. 931, § 1 consiste donc en ce que confession et communion peuvent se faire pendant l’octave qui suit le jour auquel est attachée l’indulgence ; par comparaison avec le § 2, on peut conclure que cette permission ne s’applique pas seulement aux fêtes ayant une octave liturgique, mais doit s’entendre dans le sens de huit jours, c’est-à-dire neuf, celui auquel est attachée l’indulgence compris. La disposition du can. 931, § 2 est nouvelle et s’applique à tous les triduums, octaves, neuvaines, retraites, etc.
- – 2° Dispense de la confession actuelle. – CAN. 931, § 3. Les fidèles qui ont l’habitude de s’approcher deux fois par mois du sacrement de pénitence, à moins qu’ils n’en soient légitimement empêchés, ou de recevoir quotidiennement la sainte communion en état de grâce et avec une intention droite et pieuse, quoiqu’ils s’abstiennent de communier une ou deux fois par semaine, peuvent gagner toutes les indulgences, même sans la confession actuelle qui autrement serait nécessaire à cet effet, sauf les indulgences du jubilé ordinaire ou extraordinaire ou ad instar.
Le can. 931, § 3 accorde la dispense de la confession requise comme telle pour gagner l’indulgence dans deux hypothèses distinctes : le fidèle a l’habitude de se confesser deux fois par mois, quel que soit le délai entre les deux confessions (la S. Congr. des Indulgences avait admis, le 9 décembre 1763, la confession hebdomadaire¹⁰² et accordé ensuite plusieurs indults admettant la confession toutes les deux semaines¹⁰³) ; ou bien il a l’habitude de communier tous les jours (cas reconnu par la S. Congr. des Indulgences le 14 février 1906¹⁰⁴), même si, n’ayant aucun péché mortel sur la conscience, il ne se confesse pas de toute l’année. L’habitude n’est pas rompue si un motif sérieux empêche l’une des deux confessions mensuelles, ou si la communion n’a lieu que cinq jours par semaine.
Conformément à la doctrine établie sous l’ancien droit¹⁰⁵, la dispense ne vaut pas lors des jubilés ordinaires, c’est-à-dire tous les vingt-cinq ans, ou extraordinaires, par ex. lors de l’avènement d’un pape (ou autres indulgences assimilées). - Cumul d’indulgence. – 1° Avec une action obligatoire. – CAN. 932. Une indulgence ne peut être gagnée par une œuvre à laquelle on est obligé en vertu d’une loi ou d’un précepte, à moins qu’il n’en soit dit autrement dans la concession ; celui qui accomplit une œuvre imposée comme pénitence sacramentelle et éventuellement enrichie d’indulgences peut à la fois satisfaire à la pénitence et gagner les indulgences.
L’œuvre prescrite pour gagner les indulgences doit être surérogatoire. Telle est déjà l’opinion indiquée comme la plus probable par Benoît XIV¹⁰⁶. La S. Congr. des Indulgences déclara cependant en 1841¹⁰⁷ que la confession et la communion faites pour satisfaire au précepte pascal peuvent servir pour gagner une indulgence plénière, sauf, ajouta-t-elle en 1844¹⁰⁸, celle du jubilé. Cette exception au can. 932, quoique non indiquée par lui, semble toujours en vigueur. Celle, au contraire, mentionnée dans la seconde partie du canon fut affirmée par la S. Congr. des Indulgences le 14 juin 1901¹⁰⁹ ; la pénitence sacramentelle a pour but la diminution de la peine temporelle due au péché déjà pardonné, il n’y a donc aucune opposition à ce que cette diminution soit encore accrue par le gain d’indulgences proprement dites.
La première partie du can. 932 ne joue que lorsqu’il y a vraiment loi ou précepte : le prêtre, par ex., ne peut gagner d’indulgences en récitant le bréviaire¹¹⁰ ; par contre, les religieux accomplissant des œuvres pies imposées par la règle mais non sous peine de péché peuvent en même temps gagner des indulgences. - – 2° Avec une autre indulgence. – CAN. 933. Plusieurs indulgences peuvent être attachées à un et même objet ou endroit pour différents motifs ; mais plusieurs indulgences attachées à une et même œuvre pour différents motifs ne peuvent être acquises en même temps, à moins que cette œuvre ne soit la confession ou la communion ou qu’il n’en ait été expressément statué autrement.
Le double principe établi au can. 933 fut affirmé par la S. Congr. des Indulgences dans une réponse particulière du 29 février 1820¹¹¹ ; elle formula par la suite l’exception indiquée au can. 933 pour la communion¹¹² et la confession¹¹³. Enfin, le 12 juin 1907, elle promulgua le premier statut exprès contraire en permettant de gagner par le chapelet à la fois les indulgences dominicaines et celles des croisiers. Le 14 juin 1922, la S. Pénitencerie déclara que les indulgences apostoliques¹¹⁴ pouvaient être acquises en même temps que toute autre¹¹⁵. - Prières prescrites. – 1° Pour le pape. – CAN. 934, § 1. Si une prière, quelconque, à l’intention du Souverain pontife, est prescrite pour gagner les indulgences, une oraison seulement mentale n’est pas suffisante, mais la prière vocale est laissée au choix des fidèles, à moins qu’un texte particulier ne soit assigné.
Les auteurs se demandant si les prières requises pour gagner les indulgences devaient être vocales ou mentales, Benoît XIV, en ce qui concerne la visite des basiliques romaines pour le jubilé de 1750, exigea et déclara suffisante une prière vocale¹¹⁶.
Sauf indication contraire de la concession, le choix de la formule à réciter aux intentions du Souverain pontife est laissé aux fidèles. La S. Congr. des Indulgences s’est refusée de décider combien de Pater ou Ave devaient être dits ; à l’occasion du jubilé de 1925, la S. Pénitencerie déclara que cinq Pater, Ave et Gloria suffisaient, sans dire qu’ils étaient nécessaires¹¹⁷ ; par contre elle déclara, le 13 janvier 1930¹¹⁸, que pour gagner les indulgences de la Portioncule il fallait réciter six Pater, Ave et Gloria, et, le 5 juillet suivant¹¹⁹, qu’il en allait de même pour les indulgences plénières analogues toties quoties, comportant une visite d’église ; elle ajouta, le 20 septembre 1933¹²⁰, qu’un Pater, un Ave et un Gloria suffisaient pour gagner les autres indulgences subordonnées à la condition de prier aux intentions du Souverain pontife.
Le can. 934 n’exige la prière vocale que lorsqu’il s’agit de prières aux intentions du pape ; un collateur inférieur pourra l’imposer pour des prières prescrites à d’autres intentions et requises à l’effet d’indulgences concédées par lui. - – 2° Libre choix de la langue. – CAN. 934, § 2. Si une prière particulière est assignée, les indulgences peuvent être gagnées en quelque langue qu’elle soit récitée, pourvu que la fidélité de la traduction ait été constatée par une déclaration de la S. Pénitencerie ou de l’un des Ordinaires des lieux où a cours la langue vulgaire dans laquelle est traduite la prière ; mais les indulgences cessent complètement dès qu’il y a quelque addition, soustraction ou interpolation.
Il va de soi que si aucune formule n’est imposée, la langue à employer est libre. En outre, la S. Congr. des Indulgences, le 30 septembre 1852¹²¹, avait admis la traduction des prières indulgenciées publiées dans la Raccolta, tout en se réservant l’approbation éventuelle des versions complètes de cette collection. Le 29 décembre 1864¹²² elle reconnut le pouvoir des Ordinaires, déjà admis dans des cas particuliers, d’approuver la traduction de prières indulgenciées séparées.
Beaucoup d’auteurs admettent que la fidélité d’une traduction manuscrite destinée à l’usage privé ne doit pas être officiellement constatée. En ce qui concerne l’imprimatur, le choix de l’Ordinaire du lieu (can. 1385, § 1 ; 1388) est restreint par le can. 934, § 2 : il faut que cet Ordinaire soit un de ceux où la langue de la traduction est employée usuellement par la population de l’endroit.
La fin du can. 934, § 2 reprend en partie les termes mêmes d’un décret du S. Office du 22 juin 1916¹²³ : le texte d’une prière indulgenciée ne peut subir de modification. La S. Pénitencerie entendit d’abord cette règle dans un sens très rigoureux¹²⁴ ; cependant, le 21 janvier 1921¹²⁵, elle déclara que le can. 934, § 2 ne révoquait pas les privilèges particuliers qui auraient permis l’adaptation de certaines prières, et elle provoqua même la concession de nouveaux indults dans des cas d’espèce. Enfin elle statua, le 26 novembre 1934¹²⁶, que les seuls changements qui empêchaient de gagner l’indulgence étaient ceux qui atteignaient la substance du texte. - – 3° Récitation en groupe. – CAN. 934, § 3. Pour gagner l’indulgence, il suffit de réciter la prière alternativement avec un compagnon, ou de la suivre en esprit tandis qu’un autre la récite.
La S. Congr. des Indulgences avait admis la récitation alternée, le 29 février 1820¹²⁷ ; il suffit d’ailleurs, lorsqu’une prière vocale est nécessaire, qu’un seul la récite et que les autres la suivent en esprit. - Commutation des œuvres prescrites. – 1°. Par le confesseur. – CAN. 935. Les confesseurs peuvent changer les œuvres pies imposées pour gagner les indulgences, en faveur de ceux qui sont empêchés légitimement de les accomplir.
Le Saint-Siège n’avait accordé aux confesseurs des pouvoirs de commutation que dans des circonstances tout à fait particulières¹²⁸, jusqu’à ce que, le 18 septembre 1862, la S. Congr. des Indulgences¹²⁹ concédât à tous certaines facultés de commutation pour les indulgences plénières que les fidèles pourraient normalement gagner « au lieu où ils vivent ». Beaucoup d’auteurs admettent que cette limitation affecte également les pouvoirs très étendus que le can. 935 accorde dès qu’il y a empêchement d’accomplir quelque œuvre que ce soit, prescrite pour gagner les indulgences. La Commission d’interprétation du Code a déclaré, le 19 janvier 1940, que les confesseurs peuvent modifier la détermination de l’église à visiter, même pour les indulgences de la Portioncule¹³⁰.
Il faut toujours une certaine similitude et équivalence dans la commutation. La plupart des auteurs admettent que le confesseur exerce son pouvoir même en dehors du confessionnal vis-à-vis de tous ceux qu’il pourrait entendre en confession¹³¹, et qu’il commute même la confession éventuellement prescrite. - – 2° Sans intervention quelconque. – CAN. 936. Les muets peuvent gagner les indulgences attachées à des prières publiques, s’ils élèvent leur âme à Dieu, en de pieux sentiments, avec les autres fidèles priant dans le même lieu ; s’il s’agit de prières privées, il suffit qu’ils les fassent en esprit, en y ajoutant des signes ou en les parcourant seulement des yeux.
La première partie de ce can. 936 reprend divers termes au décret de la S. Congr. des Indulgences du 15 mars 1852 concernant les sourds-muets¹³². Celui-ci exigeait l’intervention du confesseur lorsqu’il s’agissait de prières privées, mais déjà une réponse particulière du 18 juillet 1902¹³³ avait supprimé cette intervention. Le can. 936 parle des muets en général, bien que, en ce qui concerne les prières dites en même temps que des non-muets, le can. 934, § 3 trace une règle de conduite suffisante pour ceux qui ne sont privés que de l’usage de la parole.
Un décret de la S. Pénitencerie du 22 octobre 1917 a supprimé pour les mutilés les modalités devant accompagner une prière indulgenciée, par ex. se mettre à genoux, qu’ils seraient incapables d’accomplir¹³⁴.
La S. Congr. des Indulgences décida, le 2 août 1760, d’accorder aux associations pieuses en faisant la demande que leurs membres infirmes ou incarcérés puissent gagner les indulgences accordées à leur groupement en remplaçant la visite d’église éventuellement requise par une autre œuvre pieuse¹³⁵. Un nouveau décret du 20 août 1887¹³⁶ accorda ce privilège à toutes les associations sans qu’elles aient à présenter de demande à cet effet. Le privilège est toujours en vigueur, aucune intervention du confesseur n’est nécessaire.
NOTES
¹ Decr., l. V, tit. vii, c. 13.
² La tradition la fait remonter à 1223 ; cette date n’est pas absolument prouvée.
³ Extravag. comm., l. V, tit. ix, c. 1.
⁴ Extravag. comm., l. V, tit. ix, c. 2 ; Denz., n. 550-552.
⁵ Cf. les propositions condamnées par la Constitution de Martin V du 22 février 1418 (Fontes, n. 43 ; Denz., n. 622, 676).
⁶ Cf. les propositions 18 à 22 de Luther condamnées dans la Constitution de Léon X du 15 juin 1520 (Fontes, n. 72 ; Denz., n. 758-762).
⁷ Sess. XXV (Denz., n. 989). – Cf. également la Constitution de Pie VI du 28 août 1794 (Fontes, n. 475 ; Denz., n. 1541-1543).
⁸ Constitution du 26 juin 1740 (Fontes, n. 400).
⁹ Cf. les réponses particulières de la S. Congr. des Indulgences du 28 juillet 1840, et de la S. Congr. de la Propagande du 27 septembre 1843 (Fontes, n. 5015, 4805).
¹⁰ Decr., l. V, tit. xxxviii, c. 4.
¹¹ Can. 61. Decr., l. V, tit. xxxviii, c. 14.
¹² Réponse particulière de la S. Congr. des Indulgences du 12 janvier 1878 (Fontes, n. 5081).
¹³ Fontes, n. 5137.
¹⁴ Acta, t. XXXIV, p. 241.
¹⁵ Cf. notamment la décision de la S. Congr. de la Propagande du 8 juillet 1774 (Fontes, n. 4566).
¹⁶ Les 11 décembre 1838 et 12 janvier 1878 (Fontes, n. 5009, 5081).
¹⁷ Fontes, n. 186.
¹⁸ Fontes, n. 457.
¹⁹ Fontes, n. 186.
²⁰ Elle est reproduite en appendice au pontifical romain. Réponses particulières des 23 mai 1835 et 7 décembre 1844 (Fontes, n. 5873, 5921). Des indults particuliers furent concédés pour lire la formule finale uniquement en langue vulgaire : réponse particulière du 5 mars 1847 (Fontes, n. 5949).
²¹ Réponse particulière du 15 janvier 1847 (Fontes, n. 5941).
²² Acta, t. XXII, p. 195.
²³ Cf. la réponse particulière du 22 mars 1879 (Fontes, n. 5088).
²⁴ Fontes, n. 586.
²⁵ Le rite de la bénédiction papale fut inséré dans le rituel romain lui-même (tit. VIII, ch. 32), tandis que les deux formules approuvées par Léon XIII n’y furent reprises qu’en appendice. L’édition de 1925, au contraire, les a également insérées dans le rituel lui-même (tit. VIII, ch. 33). Cf., au sujet de l’emploi de l’une ou l’autre de ces formules, les réponses particulières de la S. Congr. des Indulgences des 19 décembre 1885 et 11 novembre 1903 (Fontes, n. 5091, 5138).
²⁶ Décret du 4 février (Fontes, n. 4979).
²⁷ Le 15 décembre (Fontes, n. 1289).
²⁸ Le 28 mai (Fontes, n. 1297).
²⁹ Acta, t. XXXII, p. 199.
³⁰ La Constitution de Benoît XV du 15 juin 1917 reconnut aux prêtres membres de la pieuse société du trépas de S. Joseph l’indult personnel de l’autel privilégié en faveur des agonisants (Acta, t. X, p. 317).
³¹ Cf. infra, can. 925, § 1. La communion du prêtre peut, au contraire, entrer en ligne de compte pour le gain d’une autre indulgence : réponse particulière de la S. Congr. des Indulgences du 10 mai 1844 (Fontes, n. 5033).
³² Fontes, n. 1291.
³³ Fontes, n. 281.
³⁴ Fontes, n. 4983.
³⁵ 30 janvier 1760 (Fontes, n. 4981).
³⁶ 18 septembre 1776 et 10 septembre 1781 (Fontes, n. 4997, 4999).
³⁷ 7 juin 1842 (Fontes, n. 5024).
³⁸ 24 mai 1843 (Fontes, n. 5031).
³⁹ Fontes, n. 4991.
⁴⁰ Fontes, n. 706.
⁴¹ Acta, t. XXVI, p. 606.
⁴² Fontes, n. 4991.
⁴³ Décret de la S. Congr. de la Propagande du 13 août 1774 (Fontes, n. 4167).
⁴⁴ Sess. XXI, De reform., chap. IX.
⁴⁵ Constitution de Clément VIII du 7 décembre 1604 (Fontes, n. 192).
⁴⁶ Réponses particulières de la S. Congr. du Concile du 21 juin 1760 (Fontes, n. 3701) et du S. Office du 8 juillet 1846 (Fontes, n. 898).
⁴⁷ Réponse particulière du 11 juillet 1839 (Fontes, n. 5012).
⁴⁸ La première édition fut faite par T. Galli en 1807.
⁴⁹ Recueil de prières et œuvres pies enrichies d’indulgences par les Souverains pontifes.
⁵⁰ Acta, t. XX, p. 200.
⁵¹ Acta, t. XXX, p. 110. L’édition porte le millésime de 1938.
⁵² Acta, t. XLII, p. 404-405.
⁵³ Décret de cette Congr. du 28 janvier 1756, décret confirmatoire du 14 avril 1856 (Fontes, n. 4980, 5057).
⁵⁴ Ordo servandus in S. Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae, 29 septembre 1908, Normae peculiares, ch. VII, art. 1, § 3 (Fontes, n. 6460).
⁵⁵ Fontes, n. 685.
⁵⁶ Fontes, n. 707.
⁵⁷ Fontes, n. 6450. Cf., concernant les indulgences à gagner par les Orientaux catholiques, les décisions de la S. Pénitencerie des 29 avril 1930, 31 janvier 1931, 22 avril 1944, et de la S. Congr. orientale des 3 avril 1934, 7 avril et 10 août 1943 (Acta, t. XXII, p. 292 ; t. XXIII, p. 88 ; t. XXVI, p. 317 ; t. XXXV, p. 146-147 ; t. XXXVI, p. 155, et 245).
⁵⁸ 18 septembre (Fontes, n. 5064).
⁵⁹ Réponse particulière du 15 mars (Fontes, n. 5047).
⁶⁰ Réponses particulières des 12 décembre 1731, 8 février 1762, 12 juillet 1847 (Fontes, n. 4965 ; 4992, 5042).
⁶¹ Réponse particulière du 6 mai 1852 (Fontes, n. 5049).
⁶² Fontes, n. 5050.
⁶³ 12 janvier (Fontes, n. 5083).
⁶⁴ 13 juin (Fontes, n. 1291).
⁶⁵ Acta, t. XIII, p. 165.
⁶⁶ Réponse non publiée aux Acta. On la trouve dans les Periodica de re morali, t. XXVII, 1938, p. 261.
⁶⁷ Fontes, n. 1303.
⁶⁸ Acta, t. XXXI, p. 23.
⁶⁹ Fontes, n. 5083.
⁷⁰ Acta, t. XXII, p. 43.
⁷¹ Cf. réponse particulière du 12 janvier 1878 (Fontes, n. 5082).
⁷² Fontes, n. 1290.
⁷³ Réponse particulière du 9 août 1843 (Fontes, n. 5012).
⁷⁴ Réponses particulières du 29 mars 1886 et du 7 juillet 1905 (Fontes, n. 3096, 5140).
⁷⁵ Acta, t. XIII, p. 164.
⁷⁶ Fontes, n. 4045.
⁷⁷ Par ex. réponses particulières des 14 décembre 1722, 12 juillet 1817, 16 juillet 1887 (Fontes, n. 4962, 5043, 5102).
⁷⁸ Réponse particulière du 10 juillet 1896 (Fontes, n. 5128).
⁷⁹ Réponses particulières des 13 novembre 1837 et 20 août 1844 (Fontes, n. 5006, 5031).
⁸⁰ Réponse particulière du 16 décembre 1760 (Fontes, n. 4988).
⁸¹ Réponses particulières des 22 août 1842 et 20 août 1844 (Fontes, n. 5028, 5034).
⁸² Acta, t. XVIII, p. 24.
⁸³ Constitutions des 25 novembre et 3 décembre 1749 (Fontes, n. 402, 404).
⁸⁴ Fontes, n. 5078.
⁸⁵ Fontes, n. 6450. Cf., concernant les indulgences à gagner par les Orientaux catholiques, les décisions de la S. Pénitencerie des 29 avril 1930, 31 janvier 1931, 22 avril 1944, et de la S. Congr. orientale des 3 avril 1934, 7 avril et 10 août 1943 (Acta, t. XXII, p. 292 ; t. XXIII, p. 88 ; t. XXVI, p. 317 ; t. XXXV, p. 146-147 ; t. XXXVI, p. 155, et 245).
⁸⁶ S. Congr. des Indulgences, réponses du 20 août 1822 et du 22 février 1847 (P. Cimetier, Consultations de droit canonique, t. 6, p. 205).
⁸⁷ Une réponse de la S. Congr. des Indulgences du 12 mars 1855 (Fontes, n. 5054) déclare qu’aucune intention n’est nécessaire. Si la messe est dite pour un seul défunt, l’indulgence plénière lui est applicable automatiquement ; si la messe est célébrée pour plusieurs défunts (comme lors de la deuxième ou troisième messe du 2 novembre), le prêtre choisira l’un d’entre eux pour lui appliquer l’indulgence ; on admet cependant qu’il puisse célébrer pour un petit nombre de défunts et laisser à Dieu le choix d’appliquer à l’un d’eux l’indulgence.
⁸⁸ Fontes, n. 5130.
⁸⁹ Fontes, n. 4951. – Cf. la Constitution de Benoît XIV du 3 décembre 1749, les réponses particulières de la même Congr. des 14 décembre 1717 et 13 septembre 1905 (Fontes, n. 404, 4958, 5111).
⁹⁰ Fontes, n. 5068.
⁹¹ Fontes, n. 1298.
⁹² Fontes, n. 1286.
⁹³ Fontes, n. 5051.
⁹⁴ Cf. supra, can. 919, § 1.
⁹⁵ Le S. Office a déclaré, le 9 novembre 1922, que l’indulgence de l’autel privilégié applicable aux agonisants (cf. supra, p. 185, n. 4) subsistait après le Code, quoiqu’elle déroge au can. 930 (Monitore ecclesiastico, t. XXXV, 1923, p. 264).
⁹⁶ Fontes, n. 4982.
⁹⁷ Fontes, n. 5020.
⁹⁸ Cf. p. 194, n. 6. Dans la suite, la S. Congr. accorda des indults pour les régions où il y avait pénurie de prêtres, permettant la confession dans la semaine précédant la fête : cf. décisions des 12 juin 1822 et 20 juin 1836 (Fontes, n. 5003, 5005). Le mot semaine était à prendre dans le sens de huit jours : réponse particulière du 15 décembre 1841 (Fontes, n. 5020).
⁹⁹ Fontes, n. 5144.
¹⁰⁰ Fontes, n. 1296.
¹⁰¹ Fontes, n. 5003.
¹⁰² Fontes, n. 5077.
¹⁰³ Fontes, n. 4993. – C’est-à-dire au moins tous les sept jours, ainsi que le déclara la S. Congr. des Indulgences les 23 novembre 1878 et 25 février 1886 (Fontes, n. 5086, 5095).
¹⁰⁴ C’est-à-dire tous les quatorze jours, ainsi que le déclara la S. Congr. des Indulgences les 23 novembre 1878 et 25 février 1886.
¹⁰⁵ Fontes, n. 5143.
¹⁰⁶ Réponses particulières de la S. Congr. des Indulgences des 12 mars 1855 et 5 décembre 1893 (Fontes, n. 5053, 5123).
¹⁰⁷ Constitution du 3 décembre 1749 (Fontes, n. 404).
¹⁰⁸ Réponses des 19 mars et 15 décembre (Fontes, n. 5018, 5021).
¹⁰⁹ Réponse particulière du 10 mai (Fontes, n. 5033).
¹¹⁰ Fontes, n. 5134.
¹¹¹ Réponse particulière de la S. Congr. des Indulgences du 29 mai 1841 (Fontes, n. 5019).
¹¹² Fontes, n. 5000.
¹¹³ Réponse particulière du 19 mars 1841 (Fontes, n. 5018).
¹¹⁴ Réponse particulière du 12 janvier 1878 (Fontes, n. 5082).
¹¹⁵ Ce sont les indulgences publiées par tout nouveau pape pour la durée de son pontificat ; elles nécessitent l’emploi d’un objet légitimement bénit.
¹¹⁶ Acta, t. XIV, p. 394.
¹¹⁷ Constitutions des 25 novembre et 3 décembre 1749 (Fontes, n. 402, 404).
¹¹⁸ Réponses particulières des 29 mai 1841 et 13 septembre 1888 (Fontes, n. 5019, 5110).
¹¹⁹ Acta, t. XVII, p. 342.
¹²⁰ Acta, t. XXII, p. 43.
¹²¹ Acta, t. XXV, p. 303.
¹²² Acta, t. XXV, p. 446.
¹²³ Fontes, n. 5051.
¹²⁴ Cf. également la réponse du 6 mai 1887 (Fontes, n. 5072, 5100).
¹²⁵ Fontes, n. 1301.
¹²⁶ Cf. les réponses particulières de la S. Pénitencerie du 21 juillet 1919 et du 27 juillet 1920 (Acta, t. XI, p. 18, 548).
¹²⁷ Acta, t. XIII, p. 163.
¹²⁸ Acta, t. XXVI, p. 643.
¹²⁹ Fontes, n. 5000.
¹³⁰ Cf. par ex. la Constitution de Benoît XIV du 3 décembre 1749, concernant les pouvoirs des pénitenciers mineurs lors du jubilé de 1750, et le décret de la S. Congr. de la Propagande du 19 septembre 1773, accordant à tous les confesseurs d’Extrême-Orient des facultés de commutation en faveur des confrères du Saint-Rosaire (Fontes, n. 401, 4560).
¹³¹ Fontes, n. 5065. Cf. la réponse particulière du 16 janvier 1886 (Fontes, n. 5093).
¹³² Acta, t. XXXII, p. 166.
¹³³ Cf. la réponse particulière de la S. Congr. de la Propagande du 20 février 1801 (Fontes, p. 4665).
¹³⁴ Fontes, n. 5046.
¹³⁵ Fontes, n. 5135.
¹³⁶ Acta, t. IX, p. 530.
¹³⁷ Fontes, n. 4987.
¹³⁸ Fontes, n. 5106. Cf. au préalable les réponses particulières des 25 février 1877 et 16 juillet 1887 (Fontes, n. 5080, 5103).