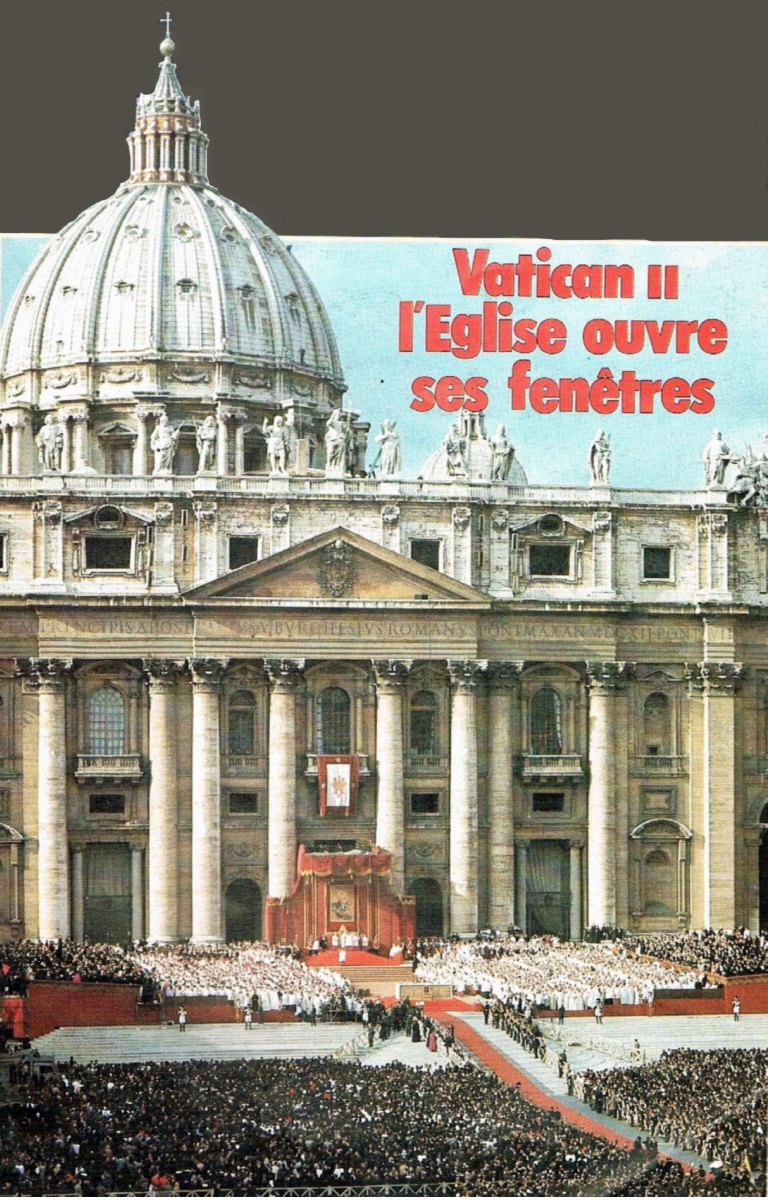Table des matières
– Juridiction dans l’Église actuelle
– 1. Chapitre 1 : Vatican II est hérétique
– Préliminaires : Définitions d’hérésie et d’hérétique
– 1. Définition de l’hérésie
– 2. Définition de l’hérétique
– 3. Distinctions supplémentaires
– 4. Traitement de l’hérétique matériel
– 5. Conséquences canoniques pour l’hérétique formel
– 6. Fondement théologique
– Conclusion
– 1.1 Les arguments principaux
– 1.1.1. Indifférentisme religieux
– 1.1.2. Faux œcuménisme
– 1.1.3. Liberté religieuse
– 1.1.4. Collégialité épiscopale
– 1.1.5. Nature de l’Église
– 1.2. Note détaillée
– 1.2.1. Contexte historique du Concile de Vatican II
– 1.2.2. Arguments : Analyse détaillée
– 1.2.2.1. Indifférentisme religieux
– 1.2.2.2. Faux œcuménisme
– 1.2.2.3. Liberté religieuse
– 1.2.2.4. Collégialité épiscopale
– 1.2.2.5. Nature de l’Église et l’usage de « subsistit in »
– 1.3. Autres considérations
– 1.4. Citations clés
Préliminaires : définitions d’hérésie et d’hérétique
Selon la doctrine de l’Église catholique, fondée sur les Écritures, les Pères, les Docteurs, les conciles œcuméniques et le Code de droit canonique de 1917 , les termes « hérésie » et « hérétique » ont des définitions précises, théologiques et canoniques, avec une distinction essentielle entre les notions formelle et matérielle.
1. Définition de l’hérésie
L’hérésie est une erreur doctrinale grave qui contredit un dogme de foi défini par l’Église. Elle est classiquement définie comme suit :
« Hæresis est error pertinax circa veritatem fidei divinae et catholicae » (DTC, art. Hérésie, col. 2225), c’est-à-dire une erreur opiniâtre contre une vérité de foi divine et catholique. Elle se divise en deux catégories :
– Hérésie formelle : C’est le rejet ou le doute obstiné, après le baptême, d’une vérité révélée par Dieu (dans l’Écriture ou la Tradition) et proposée comme devant être crue « de fide » par le magistère infaillible de l’Église (concile, ex cathedra, ou enseignement universel). Elle implique :
– Une pleine conscience de cette vérité révélée.
– Une erreur volontaire : un assentiment volontaire à une proposition contraire à la Révélation.
– Une « pertinacia » (résistance volontaire à la correction de l’Église).
– Hérésie matérielle : C’est une erreur sur un point de doctrine défini, mais sans intention délibérée ni connaissance claire de s’opposer à l’Église.
Elle survient :
– Par ignorance invincible ou erreur sincère.
– Sans culpabilité formelle ni pertinacité.
Exemples historiques : l’arianisme (négation de la divinité du Christ), le pélagianisme (négation du péché originel), ou le modernisme (condamné par Pie X en 1907).
2. Définition de l’hérétique
Un hérétique est un baptisé qui commet une hérésie. Le Code de droit canonique de 1917 (canon 1325, §2) stipule : « Post receptum baptismum, si quis, pertinaciter, dogma catholicæ fidei deneget vel dubitet, est hæreticus » (Après le baptême, celui qui nie ou doute avec pertinacité d’un dogme de foi catholique est un hérétique).
La distinction formelle/matérielle s’applique :
– Hérétique formel : Celui qui, sachant qu’une vérité est révélée et définie par l’Église, la rejette librement et obstinément.
– « Est hæreticus formalis, qui veritatem revelatam, pro talis cognitam, pertinaciter negat » (DTC, Hérésie, col. 2226).
– Il est pleinement coupable, pécheur, et excommunié « latae sententiae » (canon 2314, §1).
– Hérétique matériel : Celui qui rejette une vérité de foi sans savoir qu’elle est révélée et définie, par ignorance ou erreur non volontaire.
– « Est hæreticus materialis, qui eam ignorantiæ vel erroris causa negat » (DTC, ibid.).
– Il est dans l’erreur objectivement, mais sans culpabilité subjective ni pertinacité.
3. Distinctions supplémentaires
– Public vs Occulte :
– L’hérétique formel « public » manifeste son erreur extérieurement (paroles, écrits, enseignements) et est juridiquement sanctionné.
– L’hérétique « occulte » garde son erreur dans sa conscience sans la rendre publique ; il n’est pas traité comme hérétique au sens canonique, bien que son péché intérieur reste grave s’il est formel.
– Conditions :
– Baptême valide : Seuls les baptisés peuvent être hérétiques, car ils sont tenus à la foi catholique.
– Objet matériel : Le rejet ou doute doit porter sur un dogme.
– Pertinacité : Une opposition constante et volontaire est requise pour l’hérésie formelle, mais absente dans le cas matériel.
4. Traitement de l’hérétique matériel
Contrairement à l’hérétique formel, l’hérétique matériel n’encourt pas les mêmes sanctions automatiques, car il manque de pertinacité et de culpabilité subjective. Voici les détails de son statut selon la doctrine pré-1962 :
– Pas d’excommunication « latae sententiae » :
– L’excommunication automatique (canon 2314, §1) s’applique uniquement à l’hérétique formel, car elle nécessite une pertinacité volontaire. L’hérétique matériel, agissant par ignorance ou erreur sincère, n’est pas considéré comme un rebelle conscient à l’Église. Ainsi, il ne perd pas ipso facto la communion ecclésiale.
– Perte d’office « ipso facto » ?
– Selon le Code de 1917 , la perte d’un office ecclésiastique (canon 188, §4) ou l’incapacité à en recevoir un (canon 2314, §1) s’applique aux clercs qui commettent des délits graves, comme l’hérésie publique et notoire. Cependant, pour l’hérétique matériel, cette sanction ne s’applique pas automatiquement :
– S’il occupe un office (prêtre, évêque, etc.) et professe une hérésie matérielle sans la rendre publique, il conserve son office tant que son erreur reste occulte ou non jugée par l’autorité ecclésiastique.
– Si son erreur devient publique (par exemple, en enseignant une doctrine erronée sans savoir qu’elle est hérétique), un procès ou une monition pourrait être requis pour établir son intention. Sans pertinacité prouvée, il ne perd pas son office ipso facto , mais il pourrait être suspendu ou corrigé par ses supérieurs.
– Mise à l’écart pour protéger les fidèles ?
– L’hérétique matériel n’est pas systématiquement mis à l’écart de l’Église pour « ne pas contaminer les autres fidèles », contrairement à l’hérétique formel public, dont saint Thomas dit : «Après la première et seconde admonition, il faut éviter l’hérétique » (II-II, q. 11, a. 3), justifiant son excommunication pour protéger la communauté.
– Cependant, si l’hérétique matériel propage son erreur (par exemple, en prêchant ou enseignant publiquement une doctrine fausse, même sans malice), l’Église peut intervenir pour limiter son influence :
– Une admonition formelle pourrait lui être adressée pour corriger son erreur.
– S’il persiste après avoir été instruit, son ignorance cesse d’être invincible, et il risque de devenir formel, entraînant alors les sanctions pleines.
– En pratique, un clerc hérétique matériel public pouvait être suspendu de ses fonctions (par une sentence « ferendae sententiae » ) pour éviter la confusion parmi les fidèles, même sans excommunication immédiate.
– Correction et instruction :
– L’approche privilégiée envers l’hérétique matériel est la charité pastorale : il doit être instruit et corrigé pour revenir à la vérité. Tant qu’il n’y a pas de pertinacité, il reste membre de l’Église et peut recevoir les sacrements, sauf si son erreur publique cause un scandale manifeste nécessitant une intervention.
5. Conséquences canoniques pour l’hérétique formel
Pour comparaison :
– Excommunication « latae sententiae » (canon 2314, §1).
– Incapacité à recevoir ou exercer un office ecclésiastique (canon 188, §4).
– Privation des sacrements (sauf en danger de mort).
– Perte de juridiction si l’hérésie est publique et notoire.
– Mise à l’écart explicite pour protéger les fidèles, conformément à saint Thomas.
6. Fondement théologique
– Saint Thomas d’Aquin ( Somme théologique , II-II, q. 11) : L’hérésie formelle est un péché grave contre la foi, tandis que l’hérésie matérielle est une erreur sans malice. Pour l’hérétique matériel, l’absence de pertinacité le distingue du formel, mais son erreur publique peut justifier une intervention.
– Saint Augustin ( De Haeresibus , n. 88) : L’hérétique est un chrétien errant dans la foi ; l’intention détermine sa culpabilité.
– La doctrine pré-1962 insiste sur la vérité révélée et l’unité de l’Église : l’hérétique matériel est un cas d’errance à corriger, non de rébellion à punir immédiatement.
Conclusion
L’hérésie formelle est une révolte consciente contre un dogme, punie d’excommunication et de mise à l’écart ; l’hérésie matérielle est une erreur involontaire, sans sanctions automatiques. L’hérétique matériel ne perd pas son office « ipso facto » ni n’est excommunié « latae sententiae » , mais s’il propage publiquement son erreur, il peut être corrigé ou suspendu pour protéger les fidèles, sans être traité comme un hérétique formel tant que la pertinacité n’est pas établie.
Ce développement clarifie que l’hérétique matériel échappe aux sanctions automatiques, mais peut être sujet à des mesures disciplinaires si son erreur devient publique et risque de nuire à l’Église.
1.1 Les arguments principaux
Le Concile de Vatican II est hérétique en raison de plusieurs points, notamment l’indifférentisme religieux, le faux œcuménisme, la liberté religieuse, la collégialité épiscopale et la nature de l’Église.
Le Concile de Vatican II (1962-1965) a introduit des réformes pour moderniser l’Église catholique, mais ces changements contredisent les enseignements traditionnels. Voici les principaux arguments, présentés de manière claire :
1.1.1. Indifférentisme religieux
Le document « Nostra Aetate » reconnaît des vérités et une sainteté dans d’autres religions, ce qui est une relativisation de la foi catholique, allant à l’encontre du premier commandement et des enseignements antérieurs sur l’unicité de la vérité catholique.
1.1.2. Faux œcuménisme
« Unitatis Redintegratio » permet la prière en commun avec d’autres « chrétiens » hérétiques et schismatiques, parfois même le culte partagé, ce qui constitue une violation du droit canonique, pour pratiques sacrilèges.
1.1.3. Liberté religieuse
« Dignitatis Humanae » affirme un sois disant droit naturel à la liberté religieuse public, contradictoire avec les condamnations papales antérieures, comme celles de Pie IX, qui rejetaient un tel droit pour propager l’erreur.
1.1.4. Collégialité épiscopale
Le Concile, notamment dans « Lumen Gentium », introduit une vision de la collégialité des évêques qui diminue l’autorité papale, allant à l’encontre du premier Concile de Vatican sur la primauté papale.
1.1.5. Nature de l’Église
L’usage de « subsistit in » dans « Lumen Gentium » suggère que l’Église du Christ subsiste dans l’Église catholique romaine, mais pas exclusivement, ce qui est un abandon de l’identification traditionnelle de l’Église catholique comme seule vraie Église.
1.2. Note détaillée
Vue d’ensemble complète, en incluant des détails historiques, théologiques et contextuels, pour enrichir la compréhension du sujet.
1.2.1. Contexte historique du Concile de Vatican II
Le Concile de Vatican II, convoqué par le pape Jean XXIII en 1959 et tenu de 1962 à 1965, fut un événement majeur visant à moderniser l’Église catholique face aux changements culturels et sociaux. Il produisit 16 documents, dont des constitutions dogmatiques comme « Lumen Gentium » et des déclarations comme « Nostra Aetate » , « Unitatis Redintegratio » et « Dignitatis Humanae » . Ces textes cherchaient à renouveler la relation de l’Église avec le monde moderne, les autres religions et les chrétiens séparés. Cependant, ces réformes sont en une rupture avec la doctrine traditionnelle.
1.2.2. Arguments : Analyse détaillée
Voici plusieurs arguments pour qualifier le Concile de hérétique dans une analyse structurée :
1.2.2.1. Indifférentisme religieux
Le document « Nostra Aetate » (28 octobre 1965) traite de la relation de l’Église avec les religions non chrétiennes. Il reconnaît des éléments de vérité et de sainteté dans des religions comme l’hindouisme, le bouddhisme, l’islam et le judaïsme, encourageant le dialogue et la collaboration. Par exemple :
– Il note que les musulmans adorent un Dieu unique, miséricordieux, et partagent certaines croyances avec les chrétiens, comme le respect pour Jésus et Marie.
– Il rejette l’accusation collective des Juifs pour la mort du Christ et condamne un prétendu antisémitisme.
[Congregation of Mary Immaculate Queen](https://cmri.org/articles-on-the-traditional-catholic-faith/the-doctrinal-errors-of-the-second-vatican-council/),
Cela équivaut à un indifférentisme religieux, suggérant que toutes les religions ont une valeur égale, ce qui contredit le premier commandement et des encycliques comme « Mortalium Animos » de Pie XI (1929), qui rejetaient l’idée d’une unité religieuse sans soumission à l’Église catholique. Cela dilue l’exclusivité de la vérité catholique, affirmée dans des documents comme le « Syllabus d’erreurs » de Pie IX (1864).
1.2.2.2. Faux œcuménisme
« Unitatis Redintegratio » (21 novembre 1964), le décret sur l’œcuménisme, appelle à l’unité des chrétiens et autorise, dans certaines circonstances, la prière en commun avec des chrétiens séparés. Par exemple :
– Le paragraphe 8 permet des prières communes dans des contextes spécifiques, comme des réunions œcuméniques, tout en précisant que le culte commun (communicatio in sacris) doit être limité et décidé par l’autorité locale.
– Le paragraphe 15 encourage même le culte commun avec les « Églises » orientales schismatiques, en raison de leurs sacrements valides.
[Tradition in Action](https://www.traditioninaction.org/Questions/F042_Vatican2.html)
Ceci constitue une violation du droit canonique, notamment le Canon 1258 du Code de 1917, qui interdisait la participation aux rites sacrés avec des hérétiques.
Cela mène à des pratiques sacrilèges, comme l’administration des sacrements à des non-catholiques, contraire à des enseignements comme ceux du Concile de Trente.
1.2.2.3. Liberté religieuse
« Dignitatis Humanae » (7 décembre 1965), la déclaration sur la liberté religieuse, affirme un droit naturel à la liberté religieuse, basé sur la dignité de la personne humaine. Par exemple :
– Le paragraphe 2 déclare que personne ne doit être forcé d’agir contre ses croyances, dans les limites de l’ordre public, et que ce droit doit être reconnu dans les lois constitutionnelles.
[Congregation of Mary Immaculate Queen](https://cmri.org/articles-on-the-traditional-catholic-faith/the-doctrinal-errors-of-the-second-vatican-council/)
Cela contredit des enseignements antérieurs, tels que le « Syllabus d’erreurs » de Pie IX (propositions 78, 79), qui rejettent un droit naturel à propager l’erreur. Cela a conduit à des changements légaux, comme en Espagne (1967), favorisant la sécularisation et le déclin de la foi catholique.
1.2.2.4. Collégialité épiscopale
« Lumen Gentium » (21 novembre 1964), la constitution dogmatique sur l’Église, introduit la notion de collégialité, affirmant que les évêques, en union avec le Pape, forment un collège ayant autorité sur l’Église entière. Par exemple :
– Le chapitre 3 discute de l’autorité des évêques, suggérant une gouvernance partagée, ce qui fut débattu lors du Concile, car cela diminue la primauté papale définie par Vatican I.
[Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Vatican_Council)
Cela va à l’encontre de la définition de Vatican I sur l’infaillibilité et la primauté papale, posant une dilution de l’autorité pontificale. C’est un alignement avec des idées protestantes, critiquant une centralisation « excessive ».
1.2.2.5. Nature de l’Église et l’usage de « subsistit in »
« Lumen Gentium » utilise l’expression « subsistit in » pour dire que l’Église du Christ « subsiste dans » l’Église catholique, plutôt que « est » l’Église catholique. Par exemple :
– Le paragraphe 8 affirme : « L’Église du Christ subsiste dans l’Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. »
[Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_gentium)
C’est une abdication de l’identification exclusive de l’Église catholique comme seule vraie Église, brisant une tradition historique. « Cardinal » Ratzinger (futur Benoît XVI) expliqua que « subsistit in » permettait une compréhension plus large, mais cela fut une ouverture à une pluralité ecclésiale, contraire à des enseignements comme « Satis Cognitum » de Léon XIII (1896).
1.3. Autres considérations
Outre ces arguments principaux, soulignons l’ambiguïté des documents du Concile, estimant que cela ouvre la porte à des hérésies comme le salut universel, bien que cela ne soit pas explicitement affirmé. Jugeons le Concile par ses « fruits », citant Matthieu 7:19 pour critiquer les conséquences perçues, comme une baisse de la pratique religieuse.
[Tradition in Action](https://www.traditioninaction.org/Questions/F042_Vatican2.html)
Tableaux pour clarifier
Voici un tableau récapitulatif des arguments et des documents concernés :
| Argument | Document principal | Exemple de critique | Référence antérieure citée |
| Indifférentisme religieux | Nostra Aetate | Reconnaissance de vérités dans l’islam, perçu comme relativisme | Mortalium Animos de Pie XI (1929) |
| Faux œcuménisme | Unitatis Redintegratio | Prière commune avec hérétiques, violation du Canon 1258 | Concile de Trente, Session 13 |
| Liberté religieuse | Dignitatis Humanae | Droit naturel à la liberté religieuse, contre Pie IX | Syllabus d’erreurs (1864, propositions 78, 79) |
| Collégialité épiscopale | Lumen Gentium (Chapitre 3) | Diminution de l’autorité papale, contre Vatican I | Définition de Vatican I sur la primauté papale |
| Nature de l’Église | Lumen Gentium (Paragraphe 8) | « Subsistit in » vu comme pluralisme ecclésial | Satis Cognitum de Léon XIII (1896) |
Un autre tableau détaille les perceptions des traditionalistes sur les conséquences :
| Conséquence perçue | Exemple cité | Source de critique |
|——————————-|——————————————————-|————————————————————|
| Déclin de la pratique | Diminution des vocations, baisse de la messe dominicale | [Congregation of Mary Immaculate Queen]
(https://cmri.org/articles-on-the-traditional-catholic-faith/the-doctrinal-errors-of-the-second-vatican-council/) |
| Sécularisation accrue | Changements légaux en Espagne (1967), Brésil | Idem |
| Confusion doctrinale | Ambiguïté des textes, ouverture à des hérésies | [Tradition in Action]
(https://www.traditioninaction.org/Questions/F042_Vatican2.html) |
1.4. Citations clés
– [Vatican II Documents Nostra Aetate English Version](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html)
– [Vatican II Documents Unitatis Redintegratio English Version](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_en.html)
– [Vatican II Documents Dignitatis Humanae English Version](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html)
– [Second Vatican Council Overview Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Vatican_Council)
– [Lumen Gentium Wikipedia Page](https://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_gentium)
– [Is Vatican II Heretical or of the Holy Spirit Tradition in Action](https://www.traditioninaction.org/Questions/F042_Vatican2.html)
– [Doctrinal Errors of Second Vatican Council CMRI](https://cmri.org/articles-on-the-traditional-catholic-faith/the-doctrinal-errors-of-the-second-vatican-council/)
– [Vatican II Official Documents Archive](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index.htm)